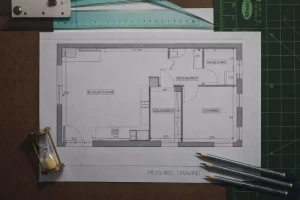CCMI : le guide pour sécuriser votre projet de construction
Faire construire sa maison est le projet d’une vie. Pourtant, certaines déconvenues peuvent être lourdes de conséquences : retards de chantier, malfaçons, surcoûts, abandon en cours de construction, voire liquidation pure et simple de l’entreprise. Chaque année, de nombreux particuliers font appel à un avocat CCMI pour les aider à finaliser leur projet.
C’est précisément pour éviter ces erreurs coûteuses que ce guide a été rédigé. Il vous donne toutes les clés pour comprendre le fonctionnement du Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI), identifier les points de vigilance et défendre vos droits en cas de difficulté.
I. Qu’est-ce qu’un CCMI ?
A. Définition et fonctionnement du CCMI
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) est un contrat réglementé par la loi qui encadre la construction d’une maison, lorsque le constructeur s’engage à réaliser un bâtiment à usage d’habitation (au moins partiellement). Sa mise en œuvre est encadrée par les articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Ce contrat s’applique dans trois hypothèses :
- Le constructeur fournit le plan de la maison (cas le plus courant) ;
- Le constructeur s’engage à faire construire un ouvrage d’après un plan établi par un tiers, mais avec mission complète de construction ;
- Le maître d’ouvrage s’adresse à un constructeur pour une prestation globale, sans intervention directe d’un architecte ou maître d’œuvre distinct.
Le CCMI impose des obligations lourdes au constructeur, notamment :
- l’obligation de respecter un prix forfaitaire ;
- l’obligation de fournir une garantie financière de livraison ;
- le respect d’un formalisme strict, à peine de nullité
Ce régime du CCMI est d’ordre public : un contrat ne respectant pas le régime du CCMI alors qu’il devrait s’y soumettre est susceptible d’être requalifié, avec à la clé des nullités et des sanctions pour le constructeur.
B. Différence avec la VEFA, la maîtrise d’œuvre et l’entreprise générale
Contrairement à la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), où l’acquéreur achète un logement en construction auprès d’un promoteur déjà propriétaire du terrain, le CCMI intervient une fois le terrain acquis par le particulier. Ce dernier conclut alors un contrat avec un constructeur pour édifier une maison sur son propre terrain. La VEFA relève d’une vente immobilière, alors que le CCMI est un contrat de prestation de services assorti de garanties spécifiques.
À l’inverse de la maîtrise d’œuvre, dans laquelle le particulier confie la conception des plans à un architecte ou maître d’œuvre puis sélectionne lui-même les entreprises intervenantes, le CCMI propose une solution dite « clé en main » : un seul interlocuteur, un prix forfaitaire, des délais encadrés et des garanties obligatoires. Ce dispositif réduit les marges de manœuvre, mais apporte un cadre protecteur pour les maîtres d’ouvrage non professionnels.
Enfin, le recours à une entreprise générale ne bénéficie d’aucun des mécanismes propres au CCMI. Ce type de contrat, conclu de gré à gré, n’offre ni garantie de livraison ni garantie de remboursement. Il s’agit d’un simple contrat d’entreprise soumis au droit commun. Or, certains constructeurs contournent volontairement le régime du CCMI en proposant ce type de montage contractuel, moins contraignant pour eux mais plus risqué pour le particulier.
C. Les acteurs du CCMI
- le constructeur : Le constructeur est le professionnel qui s’engage à édifier la maison selon les modalités prévues au contrat. Il assume une responsabilité contractuelle renforcée, notamment au titre de la conformité aux plans, au calendrier, et à la qualité des matériaux. Il est également soumis aux obligations d’assurance et de garantie.
- le maître d’ouvrage : Il s’agit du particulier qui fait construire pour lui-même. La loi lui reconnaît une position juridiquement protégée, notamment grâce aux garanties de remboursement, de livraison, et aux dispositions du Code de la consommation (délai de rétractation, formalisme contractuel…).
- le garant : Le garant est souvent une banque ou un assureur. Il intervient en dehors du contrat de construction, en fournissant une garantie extrinsèque de livraison à prix et délai convenu. En cas de défaillance du constructeur (faillite, abandon de chantier), c’est le garant qui prend le relais.
II. Avant de signer un CCMI : les points à ne pas rater
A. Choisir et acheter un terrain constructible
Le CCMI ne peut être signé qu’à la condition que le maître d’ouvrage soit propriétaire du terrain ou qu’il s’engage à l’acquérir. Cette acquisition n’est toutefois qu’une première étape : encore faut-il que le terrain soit constructible et compatible avec le projet envisagé.
B. Réaliser une étude de sol adaptée à votre terrain
Avant l’achat en CCMI, il est vivement recommandé de faire réaliser une étude de sol de type G1, surtout dans les zones argileuses ou instables. Cette étude permet d’évaluer la nature du sol et ses éventuels mouvements (gonflements, tassements), ce qui influencera directement le type de fondations à mettre en œuvre.
Depuis la loi Élan, cette étude est obligatoire dans les zones à risque (zone d’exposition moyenne ou forte aux aléas de retrait-gonflement des argiles). En cas de défaut, les coûts de fondation peuvent exploser… et ne seront pas couverts par le contrat initial.
Selon la nature du sol des études complémentaires pourraient être nécessaires : G2, G5.
C. Vérifier la compatibilité avec le PLU
Avant de signer l’acte de vente, il convient également de consulter le Plan local d’urbanisme (PLU) ou la carte communale. Certains terrains, bien que classés en zone constructible, sont soumis à des règles de hauteur, d’implantation, ou de matériaux qui peuvent bloquer ou modifier substantiellement le projet.
Une simple consultation du certificat d’urbanisme ne suffit pas. Il faut aller plus loin : examiner les prescriptions architecturales, la possibilité de raccordement aux réseaux, et le régime des servitudes éventuelles.
D. Vérifier la viabilisation du terrain
Un terrain peut être légalement constructible mais non viabilisé, c’est-à-dire non raccordé aux réseaux publics (eau, électricité, assainissement, télécom). Les travaux de viabilisation peuvent représenter des milliers d’euros supplémentaires non pris en charge par le constructeur, sauf clause expresse dans la notice descriptive.
E. Le financement de votre CCMI et la condition suspensive correspondante
Le CCMI doit contenir une clause prévoyant que le contrat ne prendra effet qu’en cas d’obtention du prêt immobilier dans un délai déterminé. Cette disposition évite à l’acquéreur d’être engagé s’il ne parvient pas à financer son projet. Le défaut d’obtention du prêt entraîne alors la caducité du contrat sans indemnité.
Afin que la condition suspensive d’obtention d’un financement vous protège, il est essentiel de :
- demander plusieurs offres de prêt,
- respecter le délai fixé dans le contrat,
- conserver la preuve de vos démarches bancaires.
Afin d’instruire votre dossier, les établissements bancaires exigent souvent la communication :
- du contrat CCMI complet (avec notice descriptive, plans, échéancier),
- du permis de construire ou de l’arrêté purgé de tout recours,
- de l’étude de sol,
- de la garantie de livraison (ou attestation de la GFA),
- des devis pour les travaux non prévus au contrat.
Un retard dans la transmission de ces pièces peut retarder le financement et compromettre le calendrier contractuel.
F. Les pièces obligatoires devant être annexée à votre CCMI
Le Code de la construction impose que le CCMI soit accompagné, à peine de nullité des documents suivants :
- les plans de construction,
- la notice descriptive conforme à l’arrêté du 27 novembre 1991 (avec détails sur les matériaux, équipements, prestations prévues),
- l’échéancier de paiement selon l’article R.231-7 du CCH,
- une attestation de garantie de livraison délivrée par le garant.
L’absence d’un seul de ces éléments est un signal d’alerte. Il convient de différer la signature jusqu’à leur régularisation complète.
G. Le délai de rétractation en CCMI
Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée lui notifiant le contrat signé. Cette faculté est d’ordre public : aucune clause ne peut la supprimer ou la réduire.
H. Le prix du CCMI : forfaitaire, ferme, révisable ?
Le prix convenu dans un CCMI doit être forfaitaire, c’est-à-dire déterminé à l’avance et non susceptible de variation unilatérale par le constructeur. Ce principe interdit au constructeur de présenter un prix indicatif ou évolutif, sauf dans les limites strictes prévues par la loi. Une révision du prix en CCMi est toutefois possible.
1) Révision du prix encadrée par l’indice BT 01
La seule faculté légale d’adapter le prix est prévue à l’article L.231-11 du CCH, qui autorise une clause de révision indexée sur l’indice national du bâtiment, dit indice BT 01. Deux mécanismes sont possibles conformément à l’article précité qui indique :
« a) Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l’indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d’une période de neuf mois suivant la date définie à l’article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l’expiration de cette période »
2) Risques de surfacturation illégale
Certains constructeurs peu rigoureux appliquent des hausses de prix non prévues contractuellement, au titre de « surcoût de chantier », « modifications réglementaires », ou « augmentation des matières premières ». Or, toute augmentation non fondée sur une clause de révision conforme est illégale et peut être refusée par le maître d’ouvrage.
I. L’échéancier de paiement en CCMI
L’article R.231-7 du CCH fixe un échéancier maximum, exprimé en pourcentage du prix convenu, en fonction de l’avancement des travaux. Le non-respect de ces plafonds expose le constructeur à des sanctions, notamment pénales.
Le calendrier de paiement est le suivant :
- a. 5 % à la signature (si garantie de remboursement fournie)
- b. 15 % à l’ouverture du chantier
- c. 25 % à l’achèvement des fondations
- d. 40 % à l’achèvement des murs
- e. 60 % à la mise hors d’eau
- f. 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air
- g. 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, plomberie, menuiseries
- h. 5 % à la réception (solde)
Chaque appel de fonds doit correspondre à un stade réellement atteint d’avancement des travaux.
Un constructeur ne peut pas exiger un paiement anticipé, même s’il prévoit un délai global raccourci. En cas de désaccord sur l’état d’avancement, il est recommandé de faire constater la réalité des travaux par un tiers (expert, architecte, maître d’œuvre, huissier).
J. La notice descriptive en CCMI
La notice descriptive est l’un des documents les plus sensibles du contrat. Elle décrit les travaux à réaliser, les matériaux utilisés, les équipements prévus, les prestations incluses (ou non) dans le prix. Elle est souvent source de contentieux, car elle engage le constructeur sur la conformité du bien livré.
1) Contenu de la notice descriptive en CCMI
La notice doit répondre aux exigences de l’arrêté du 27 novembre 1991 :
- elle doit distinguer les prestations prises en charge par le constructeur et celles à la charge du maître d’ouvrage ;
- elle doit détailler les matériaux, équipements, finitions (revêtements, sanitaires, menuiseries, etc.)
- elle doit préciser le niveau de performance énergétique (RE2020) ;
- elle doit être parfaitement lisible et compréhensible pour un non-professionnel.
En pratique, certaines notices sont volontairement imprécises : formules vagues (« équipement standard », « selon plan du fournisseur », « revêtement au choix du constructeur ») qui permettent ensuite des modifications non assumées. Il convient d’être particulièrement vigilants à ce type de clause.
2) Les pièges fréquents
- Prestations exclues sans l’indiquer clairement : clôtures, terrasses, raccordements aux réseaux
- Dégradations de qualité : matériaux de moindre performance non conformes au projet initial.
- Omniprésence des options : présentation flatteuse sur catalogue, mais choix définitif limité à des gammes minimales, sauf supplément de prix.
Le rôle de la notice descriptive est essentiel : c’est le document auquel on se réfère pour juger de la conformité de la maison livrée. En cas de contradiction entre la plaquette commerciale et la notice signée, seule la notice fait foi.
II) Pendant le chantier : restez vigilant
Une fois le chantier lancé, la vigilance du maître d’ouvrage doit rester constante. Les premières semaines de travaux conditionnent souvent la suite du projet. Un retard mal anticipé, un appel de fonds prématuré ou une modification non encadrée peuvent rapidement déséquilibrer la relation contractuelle.
A. Les éléments à vérifier au démarrage du chantier
1. Déclaration d’ouverture du chantier
Le constructeur doit déposer une déclaration d’ouverture de chantier (DOC) auprès de la mairie. Ce document, prévu par le Code de l’urbanisme, marque officiellement le début des travaux au regard des règles d’urbanisme et s’avère d’une importance capitale pour mobiliser ultérieurement l’assurance décennale.
La copie de cette déclaration doit vous être remise.
2. Affichage du panneau de chantier
Un panneau réglementaire mentionnant le numéro du permis de construire, les noms du maître d’ouvrage, de l’architecte (le cas échéant), du constructeur et la surface du projet doit être affiché sur le terrain, visible depuis la voie publique.
Cet affichage est essentiel dès l’obtention du permis de construire, car il fait courir le délai de deux mois pour les recours des tiers.
Cet affichage doit également être maintenu pendant toute la durée du chantier.
3. Vérification des assurances
Avant tout début de chantier, le maître d’ouvrage doit s’assurer que le constructeur est bien titulaire :
- d’une assurance responsabilité civile décennale,
- et que la garantie de livraison a été délivrée par le garant, avec attestation remise au client.
En parallèle, il convient de s’assurer qu’une assurance dommages-ouvrage a bien été souscrite.
B. Retards, abandons, litiges en cours de chantier en CCMI : quels recours ?
Même lorsque les relations sont saines et apaisées, le chantier peut rencontrer des difficultés. Les situations les plus fréquentes concernent le retard CCMI, les interruptions non justifiées, ou les désaccords sur l’avancement réel des travaux.
1. Retard de livraison en CCMI
Livraison d’une maison construite sous CCMI : le respect du délai contractuel
Lorsqu’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est signé, il doit obligatoirement mentionner la date ou le délai prévu pour la remise du bien, conformément aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation. Le contrat doit également préciser les pénalités applicables en cas de retard dans l’achèvement des travaux.
Dans la pratique, ce délai est généralement exprimé en nombre de mois à compter de l’ouverture du chantier (par exemple, 12 mois à partir de la date officielle de démarrage des travaux).
Si le constructeur dépasse la date prévue, il engage en principe sa responsabilité contractuelle. Toutefois, la plupart des CCMI comportent des clauses permettant de suspendre ou de prolonger le délai dans certaines situations qualifiées de causes légitimes de retard.
Les causes légitimes de report de la date de livraison
L’article L.231-3 du Code de la construction et de l’habitation encadre strictement ces causes de suspension. Seules trois situations peuvent être retenues :
- un cas fortuit,
- un événement de force majeure,
- ou des intempéries avérées.
Toute autre clause qui viserait à élargir cette liste est réputée non écrite. Autrement dit, si le constructeur invoque une cause qui ne figure pas parmi ces trois hypothèses, celle-ci ne peut justifier un report du délai.
Si une cause légitime valable est établie, le constructeur échappe aux pénalités et le maître d’ouvrage ne peut obtenir d’indemnisation pour le retard.
Les pénalités de retard prévues par la loi
En l’absence de justification valable, le constructeur est tenu de verser des pénalités au maître d’ouvrage. L’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation fixe un montant minimal : 1/3000ᵉ du prix convenu par jour de retard. Les parties peuvent prévoir un montant supérieur, mais jamais inférieur à ce seuil légal.
Il faut noter que ces pénalités ne privent pas le maître d’ouvrage de la possibilité de demander, en plus, des dommages et intérêts pour réparer d’autres préjudices liés au retard, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2022 (n° 20-21.208).
L’indemnisation des préjudices complémentaires
En cas de retard de livraison, divers préjudices peuvent survenir pour le maître d’ouvrage, tels que :
- des frais intercalaires dus au financement,
- une perte de loyers pour un bien destiné à la location,
- la privation de jouissance du logement,
- la perte d’un avantage fiscal lié à une date de livraison,
- ou encore les frais de location d’un logement de remplacement.
Dès lors que ces préjudices sont directement liés au retard, ils peuvent être indemnisés en plus des pénalités légales (Cass. civ. 3ᵉ, 27 janvier 2015, n° 13-23.948).
2. abandon de chantier en CCMI
L’abandon de chantier est une situation grave, mais juridiquement encadrée. Il peut résulter :
- d’un départ du constructeur sans justification,
- d’une cessation d’activité (dépôt de bilan, liquidation judiciaire),
- ou d’un conflit bloquant l’exécution du contrat.
Le maître d’ouvrage doit d’abord mettre en demeure le constructeur de reprendre les travaux sous un délai raisonnable. En cas d’échec et de défaillance avérée du constructeur, l’acquéreur peut saisir le garant de livraison, conformément à l’article L.231-6 du CCH, pour qu’un autre professionnel intervienne à ses frais.
3. Appels de fonds en CCMI
Chaque appel de fonds doit correspondre à un stade d’avancement réel, conforme à l’échéancier légal fixé par l’article R.231-7 du Code de la construction. Le constructeur ne peut demander un paiement anticipé ou sans justification matérielle (ex. : demande des 40 % alors que les murs ne sont pas terminés).
En cas de doute, le maître d’ouvrage est en droit d’exiger l’accès au chantier et qu’un constat d’avancement réalisé par un tiers (architecte, expert ou maître d’œuvre indépendant). Un paiement non justifié peut être suspendu, sous réserve de notifier clairement les motifs du refus.
III) Fin du chantier en CCMI : la livraison et la gestion des désordres
La livraison en CCMI est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle marque la fin du contrat et fait courir les garanties légales du droit de la construction (notamment la garantie décennale).
1) La forme de la réception des travaux
La réception des travaux peut être :
- expresse, lorsqu’un procès-verbal est signé entre les parties ;
- ou tacite, lorsque le maître d’ouvrage prend possession du bien sans émettre de protestation.
La forme écrite est toujours à privilégier. Le procès-verbal doit mentionner la date, les éventuelles réserves, ainsi que les délais de levée des réserves. Si des réserves sont formulées, le maître d’ouvrage est en droit de consigner le solde de 5 % du prix jusqu’à leur levée.
En cas de désordres graves affectant l’habitabilité ou la conformité, la réception peut être refusée par écrit. Le constructeur devra alors remédier aux anomalies avant de proposer une nouvelle réception.
2) Les effets de la réception des travaux
La réception produit plusieurs effets essentiels :
- a. Elle fait courir les garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale).
- b. Elle rend exigible le solde du prix, sauf en cas de réserves non levées.
- c. Elle transfère la garde de l’ouvrage au maître d’ouvrage, qui en devient responsable.
3) Les désordres postérieurs à la réception
Les désordres apparus après réception peuvent être pris en charge selon leur nature :
- Garantie de parfait achèvement (1 an) : tous désordres signalés lors de la réception, ou apparus dans l’année suivant la réception.
- Garantie biennale (2 ans) : dysfonctionnement d’un équipement dissociable (robinetterie, volets roulants, etc.).
- Garantie décennale (10 ans) : dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Le maître d’ouvrage doit notifier ces désordres par lettre recommandée. Lorsque l’assurance dommages-ouvrage a été souscrite, elle permet une indemnisation rapide des désordres décennaux, avant tout contentieux sur la responsabilité.
IV) Les garanties légales du CCMI
A. La garantie de livraison en CCMI
La garantie de livraison en CCMI protège l’acquéreur en cas de défaillance du constructeur (liquidation judiciaire, abandon de chantier, inexécution manifeste). Elle est fournie par un garant CCMI (banque, assureur) et prend la forme d’un engagement contractuel séparé, remis obligatoirement avant l’ouverture du chantier.
Prévue à l’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre :
- i. l’achèvement des travaux en cas de défaillance du constructeur,
- ii. le respect du prix convenu, sans augmentation illicite,
- iii. le respect du délai de livraison, sauf causes légitimes (intempéries, force majeure…).
Le garant peut faire appel à une autre entreprise pour reprendre et terminer les travaux, tout en prenant en charge les surcoûts nécessaires à l’exécution du contrat.
La procédure commence par une mise en demeure adressée au constructeur, restée infructueuse. Le maître d’ouvrage doit ensuite notifier le garant, qui dispose d’un délai pour intervenir, soit par la reprise des travaux, soit par une indemnisation. Cette garantie est obligatoire et indépendante du constructeur : elle constitue un filet de sécurité pour tout projet sous CCMI.
Il convient de ne pas confondre cette garantie de livraison avec la garantie de remboursement, prévue à l’article L.231-4 du même code, qui intervient dans une phase antérieure du projet.
La garantie de livraison protège l’achèvement du chantier après son ouverture, tandis que la garantie de remboursement protège les sommes versées avant le démarrage effectif des travaux, notamment en cas de rétractation ou de refus de prêt. Ces deux garanties ne sont pas alternatives mais complémentaires, chacune couvrant des risques bien distincts.
B. La garantie de remboursement en CCMI
Lorsque le maître d’ouvrage verse une somme avant le démarrage effectif des travaux, le constructeur est tenu de fournir une garantie de remboursement. Cette obligation est prévue à l’article L.231-4 du CCH.
Quand cette garantie est-elle exigée ?
- ii. En cas d’acompte à la signature du contrat (maximum 5 % du prix convenu)
- iii. En cas de versement avant le début du chantier.
Sans cette garantie, aucun paiement ne peut être exigé par le constructeur avant l’ouverture du chantier. En cas d’annulation du contrat (rétractation, refus de prêt, inexactitude du prix), la garantie permet de récupérer intégralement les sommes versées, sans justification particulière.
C. L’assurance dommages-ouvrage en CCMI
L’assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour toute construction relevant du CCMI. Elle doit être souscrite avant l’ouverture du chantier, conformément à l’article L.242-1 du Code des assurances.
Cette assurance permet au maître d’ouvrage d’être indemnisé rapidement, sans attendre la reconnaissance de la responsabilité du constructeur, en cas de désordre :
- compromettant la solidité de l’ouvrage,
- ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Concrètement l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement, qui permet une indemnisation rapide après déclaration du sinistre, puis se retourne contre les responsables.
D. Les garanties mobilisables après la réception des travaux
À compter de la réception des travaux, plusieurs garanties légales prennent effet automatiquement :
1) Garantie de parfait achèvement (1 an)
Prévue à l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement impose au constructeur de réparer tous les désordres qui :
- ont été signalés lors de la réception (réserves mentionnées au procès-verbal) ;
- ou qui sont apparus dans l’année qui suit la réception.
Elle couvre tous les types de désordres, y compris les malfaçons mineures, les défauts esthétiques ou les désordres de second œuvre, dès lors qu’ils sont signalés dans les délais.
Pour faire jouer cette garantie, le maître d’ouvrage doit notifier les désordres par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un an à compter de la réception.
En cas de refus ou d’inertie du constructeur, il est possible de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce aux frais du constructeur, après l’avoir mis en demeure.
2) Garantie biennale (2 ans)
La garantie biennale, prévue à l’article 1792-3 du Code civil, couvre pendant deux ans à compter de la réception les équipements dissociables de l’ouvrage, c’est-à-dire ceux qui peuvent être retirés ou remplacés sans détériorer la structure du bâtiment.
Par exemple, sont couverts :
- d. interphone,
- e. volets roulants,
- f. chauffe-eau, etc.
La garantie impose au constructeur de remplacer ou réparer ces équipements en cas de défaillance affectant leur bon fonctionnement. Elle ne couvre pas les dégradations dues à l’usure normale, aux défauts d’entretien ou à une mauvaise utilisation par l’acquéreur.
L’action doit être exercée dans le délai de deux ans suivant la réception. En pratique, un simple courrier recommandé suffit à engager la responsabilité du constructeur. En cas d’inertie, une procédure en justice peut être introduite.
3) Garantie décennale (10 ans)
La garantie décennale est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Elle couvre pendant dix ans les désordres les plus graves, à savoir :
- ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage (fissures importantes, affaissement de dalle, défaut de fondation, déformation de charpente, etc.) ;
- ou ceux qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination (infiltrations, défauts d’isolation rendant les pièces inhabitables, humidité chronique…).
Elle s’applique également aux éléments d’équipement indissociables de la structure, comme une isolation par l’extérieur, une toiture terrasse, ou un plancher chauffant intégré.
Cette garantie bénéficie au maître d’ouvrage pendant dix ans à compter de la date de réception.
En cas de sinistre, il est recommandé de :
- notifier les désordres par courrier recommandé ;
- solliciter une expertise amiable ou judiciaire pour établir le lien entre les désordres et leur origine ;
- saisir le tribunal si l’indemnisation amiable échoue.
L’action est facilitée lorsque le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage, laquelle permet d’être indemnisé rapidement, sans attendre l’issue d’un contentieux sur la responsabilité.
V) Comment résilier un CCMI ?
La résiliation du CCMI ne peut intervenir que dans des cas strictement définis par la loi. Qu’elle soit exercée à l’initiative du maître d’ouvrage ou qu’elle résulte d’un événement affectant le constructeur, la résiliation doit respecter un formalisme précis.
A) Rétractation dans les 10 jours
À compter de la remise du contrat signé, le maître d’ouvrage bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours, prévu par l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Cette rétractation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans obligation de justification.
Si un acompte a été versé avant le démarrage du chantier, la garantie de remboursement (L.231-4 CCH) permet d’en obtenir la restitution.
C’est une disposition d’ordre public : aucune clause ne peut le réduire ou le supprimer.
B) Résiliation avant ou pendant le chantier
Une fois le délai de rétractation expiré, la résiliation du CCMI ne peut intervenir que dans des hypothèses limitées :
1. Défaut de financement : en cas de refus de prêt, la condition suspensive de financement s’applique et le contrat devient caduc de plein droit, sans indemnité. Le constructeur doit restituer les sommes perçues, sauf si le maître d’ouvrage a fait obstacle volontairement à l’obtention du crédit.
2. Inexécution par le constructeur : Lorsque le constructeur ne respecte pas ses obligations (retard excessif, abandon de chantier, non-conformité grave), le maître d’ouvrage peut engager une procédure de résolution judiciaire du contrat. Il doit d’abord :
- adresser une mise en demeure motivée,
- constater l’absence de réaction,
- puis saisir le tribunal compétent.
En cas de défaillance manifeste, il est également possible de mettre en jeu la garantie de livraison, prévue à l’article L.231-6 CCH, pour faire terminer les travaux par un tiers, sans avoir à demander judiciairement la résiliation.
3. Résiliation amiable : La résiliation peut également intervenir par accord mutuel, à condition qu’elle soit formalisée par écrit et qu’elle règle expressément la question des paiements, pénalités éventuelles, et modalités de restitution des documents. Cette voie reste rare et suppose un minimum de coopération entre les parties.
Le cabinet MARTIN PEYRONNET, avocat CCMI à Bordeaux, se tient à votre disposition pour vous assister dans tous vos litiges immobiliers, à Bordeaux comme dans toute la France.
Dernière mise à jour le 2 décembre 2025 par evicoadmin