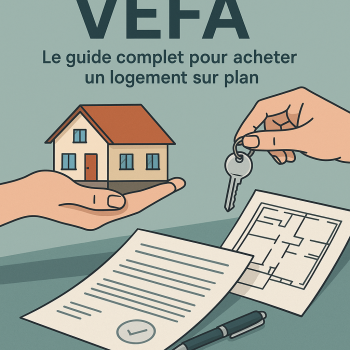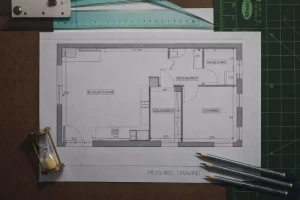L’achat en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) séduit de nombreux acquéreurs par la promesse d’un logement neuf, conforme aux dernières normes techniques et énergétiques. Pourtant, les pièges sont nombreux et les litiges fréquents.
Défauts de conformité ou délais de livraison à rallonge, acheter en VEFA peut vite virer au parcours du combattant si l’on ne maîtrise pas les règles du jeu. Ce guide vous accompagne étape par étape, de la réservation jusqu’à la livraison du bien, pour anticiper les litiges les plus fréquents VEFA.
I. Avant la signature du contrat de VEFA : sécuriser le projet
Avant votre achat, il est indispensable de connaître le fonctionnement d’un achat sur plan afin d’éviter les erreurs courantes en VEFA.
A. Qu’est-ce qu’une VEFA ? Les principales caractéristiques
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) est un contrat par lequel un acquéreur devient propriétaire d’un bien immobilier avant même que sa construction ne soit achevée. C’est ce que l’on appelle couramment une « vente sur plan ». À la signature de l’acte, le bien n’existe pas encore matériellement, mais son existence future est juridiquement encadrée.
1. Le paiement échelonné du prix
Le paiement est progressif en fonction de l’avancement des travaux et encadré par la loi, à l’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l’achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d’eau ; 95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas d’erreur de conformité en VEFA avec les prévisions du contrat. Il s’agit de la retenue de garantie en VEFA.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
- soit par versements périodiques constants ;
- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.»
En parallèle, la propriété du bien se transmet également de manière échelonnée, à mesure que les travaux avancent. Autrement dit, l’acquéreur devient propriétaire de son bien immobilier au fur et à mesure de l’avancement de la construction.
2. La différence entre la VEFA et le CCMI
Il est essentiel de distinguer la VEFA du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), car le régime juridique applicable dépend principalement de la fourniture du terrain. En VEFA, le promoteur est propriétaire du terrain au moment de la vente : il cède donc un bien immobilier à construire, terrain inclus, selon un transfert de propriété progressif encadré par les articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
À l’inverse, le CCMI s’applique uniquement lorsque le terrain appartient déjà à l’acquéreur, qui signe ensuite un contrat avec un constructeur pour édifier une maison individuelle. Ce régime est régi par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
B. Le processus d’achat en VEFA : un contrat préliminaire de réservation puis l’acte authentique
Avant la signature du contrat de VEFA, l’acquéreur signe un contrat préliminaire de réservation. Ce document est une promesse unilatérale du promoteur qui s’engage à vendre un logement à des conditions déterminées, tandis que l’acquéreur verse un dépôt de garantie, généralement équivalent à 5% du prix prévisionnel.
Le contrat de réservation est encadré par la loi, et doit comporter les mentions obligatoires prévues à l’article L.261-15 du Code de la construction et de l’habitation, notamment :
- la désignation du logement (emplacement, surface approximative, nombre de pièces) ;
- le prix prévisionnel de vente et ses modalités de révision éventuelle ;
- la date prévue pour la signature de l’acte authentique ;
- les conditions suspensives (obtention d’un prêt) ;
- le délai d’exécution des travaux ;
- la notice descriptive précisant les matériaux et équipements.
À compter de sa réception par lettre recommandée ou de sa remise en main propre contre récépissé, l’acquéreur dispose d’un délai de rétractation de dix jours en VEFA. Il peut, sans justification ni pénalité, renoncer à l’achat dans ce délai. Passé ce délai, la réservation devient contraignante et prépare la conclusion de l’acte de vente définitif.
Une fois l’acte authentique de vente signé devant notaire, l’acquéreur devient juridiquement propriétaire, selon un transfert progressif de propriété en fonction de l’avancement des travaux.
L’acte doit obligatoirement contenir, en application de l’article L. 261-11 du même Code de la construction et de l’habitation :
- une description précise du bien vendu (plans, surfaces, pièces) ;
- le prix définitif et ses modalités de paiement échelonné ;
- la situation du chantier au jour de la signature ;
- les garanties financières exigées (GFA ou garantie de remboursement) ;
- la date prévisionnelle de livraison ;
- les clauses éventuelles de pénalité ou d’indemnisation en cas de retard ;
- l’ensemble des pièces annexes : notice descriptive, attestations d’assurances, règlement de copropriété le cas échéant.
C. La notice descriptive en VEFA détermine ce que l’acquéreur achète
Souvent négligée par l’acquéreur en VEFA, la notice descriptive constitue pourtant l’un des éléments clés de ce contrat de construction. Elle fixe les engagements techniques du promoteur et détermine, en pratique, la consistance réelle du bien livré.
Le contrat de réservation, puis l’acte authentique de vente, doivent être accompagnés de ce document, visé par l’article R. 261-13 du Code de la construction et de l’habitation. Il détaille l’ensemble des caractéristiques du bien vendu : matériaux utilisés, équipements prévus, surfaces, agencement, revêtements, etc.
Contrairement à une idée reçue, cette notice ne relève pas du simple descriptif commercial : elle a une valeur contractuelle. Toute divergence entre ce document et le bien livré peut être qualifiée de défaut de conformité, ouvrant droit à des réparations, une réduction du prix ou, dans certains cas, à la résolution du contrat.
Il est donc essentiel de lire attentivement la notice, de demander des éclaircissements sur les mentions floues ou génériques (« équipement équivalent », « selon disponibilité »), et de conserver un exemplaire daté.
D. Les conditions suspensives en VEFA
En VEFA, le contrat est le plus souvent conclu sous condition suspensive d’obtention de prêt, conformément à l’article L. 313-41 du Code de la consommation. Cette clause permet à l’acquéreur d’être libéré sans pénalité si le financement est refusé par la banque dans le délai prévu. Elle vous protège : sans cette clause, un refus de prêt bancaire peut vous faire perdre votre dépôt de garantie, voire engager votre responsabilité.
Mais tant que la condition n’est pas réalisée, le contrat ne produit pas ses effets : chaque partie doit faire le nécessaire pour que la condition puisse se réaliser. L’acquéreur doit ainsi déposer une demande de prêt conforme aux termes du contrat (montant, durée, taux) et fournir les justificatifs attendus. S’il agit de mauvaise foi ou formule une demande inadaptée, la condition pourra être réputée accomplie, rendant le contrat pleinement obligatoire.
Si l’obtention du prêt échoue dans les délais, sans faute de l’acquéreur, le contrat devient caduc de plein droit. En revanche, si la défaillance résulte d’un comportement fautif ou d’un défaut de diligence, l’obligation devient exigible.
Il est donc essentiel que la clause soit rédigée de manière claire et précise, en mentionnant les caractéristiques exactes du prêt. Une demande de prêt qui ne respecte pas les critères fixés dans la clause peut vous priver de la protection qu’elle offre.
E. Les garanties financières incluses dans la VEFA
Avant la signature de l’acte authentique, le législateur impose au promoteur de sécuriser l’opération en souscrivant une garantie financière obligatoire, destinée à protéger l’acquéreur contre le risque d’inachèvement. Deux mécanismes alternatifs sont prévus par les articles L. 261-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation :
- la garantie financière d’achèvement (GFA),
- la garantie de remboursement.
• La garantie financière d’achèvement est la norme dès lors que le chantier a démarré. Elle prend la forme d’un engagement d’un tiers (banque, assureur ou société de caution mutuelle) à verser les sommes nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, même si le promoteur fait défaut.
Cette garantie est strictement financière : le garant ne réalise pas les travaux lui-même, mais finance leur poursuite. Elle peut se présenter comme une ouverture de crédit ou un cautionnement direct. Elle ne couvre pas les préjudices annexes ni les demandes de remboursement des fonds déjà versés.
En revanche, elle permet au garant de saisir le juge pour faire désigner un administrateur chargé de mener la construction à son terme, y compris en procédant à la réception de l’immeuble.
• La garantie de remboursement : si la vente est conclue avant le début du chantier, et en l’absence de garantie financière d’achèvement, le promoteur doit obligatoirement fournir une garantie de remboursement. Elle prend la forme d’un cautionnement prévu à l’article R. 261-22 CCH, par lequel un établissement s’engage à restituer les sommes perçues si la vente est annulée.
Cette garantie couvre uniquement les paiements effectués au titre du prix de vente, à l’exclusion des frais annexes (notaire, intérêts, préjudice moral).
La souscription de l’une ou l’autre de ces garanties est une condition préalable impérative à la signature de l’acte de vente, dont le notaire doit vérifier la validité. Il faut donc vérifier que l’attestation est bien annexée à l’acte, et qu’elle émane d’un organisme habilité. Toute substitution d’une garantie à l’autre n’est possible que si elle a été prévue contractuellement. À défaut, aucun changement ne peut intervenir en cours de contrat.
Ces garanties prennent fin à l’achèvement des travaux, conformément à l’article R. 261-24 CCH, et leur efficacité suppose une mise en œuvre rigoureuse. Leur objectif n’est pas de couvrir tous les aléas de la construction, mais de garantir, au minimum, que le bien sera livré, ou que les fonds versés seront récupérés.
F. La date de livraison en VEFA et les causes légitimes de retard
Dans une VEFA, la date de livraison indiquée dans le contrat est fréquemment dépassée. En effet, de nombreux contrats permettent au promoteur de repousser la livraison sans pénalité, en invoquant des événements comme des intempéries, des pénuries de matériaux ou des retards administratifs.
Ces clauses, parfois très larges, laissent une grande marge de manœuvre au vendeur et peuvent allonger considérablement les délais. L’acquéreur peut alors se retrouver bloqué plusieurs mois sans recours, en attendant la fin du chantier.
Il est donc essentiel de lire attentivement la clause relative au délai d’achèvement :
- une date ferme est-elle prévue ou une simple période (par exemple dernier trimestre 2027) ?
- les cas de retard sont-ils précisément définis ?
- une indemnisation est-elle prévue en cas de dépassement ?
Méfiez-vous des clauses floues ou trop larges, qui autorisent le promoteur à décaler la date de livraison sans justification sérieuse : elles sont souvent déséquilibrées, mais pas toujours considérées comme abusives par les Tribunaux. Par exemple, la Cour de cassation admet la clause prévoyant le doublement du délai légitimement justifié en cas de survenance d’un évènement prévu au contrat (exemple : 10 jours d’intempéries permet de justifier de 20 jours de retard).
D’une manière générale, n’oubliez pas une chose : il est possible de négocier la présence ou non d’une clause dans votre contrat, notamment une clause relative à une cause légitime de retard.
II. Pendant le chantier en VEFA : ce qu’il faut contrôler
A. Le suivi de chantier
En VEFA, l’acquéreur ne peut pas visiter librement le chantier. Pour des raisons de sécurité, l’accès est encadré. Toutefois, la plupart des contrats prévoient des visites à certaines étapes importantes, comme après la pose des cloisons ou avant la livraison finale.
Ces visites sont utiles pour suivre l’avancement des travaux et vérifier que le promoteur sollicite des paiements conformes au calendrier prévu par la loi. Pour mémoire :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l’achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d’eau ; 95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ».
Ces visites permettent également de vérifier que le logement est conforme aux plans et à la notice descriptive. C’est aussi l’occasion de repérer d’éventuels défauts ou erreurs avant la réception.
Lors des visites de chantier, il est conseillé de venir avec les plans du logement et la notice pour vérifier que tout est conforme. En cas de doute sur la qualité des travaux, mieux vaut se faire accompagner par un professionnel (architecte, expert) pour bénéficier d’un regard technique.
B. Les modifications en cours de chantier
Pendant les travaux, le promoteur peut être amené à changer certains éléments du logement (matériaux, équipements, disposition) pour faire face à des contraintes techniques. Si ces changements sont mineurs, ils peuvent être acceptés. Mais s’ils modifient de façon notable la qualité ou l’agencement du bien, ils doivent être expressément validés par l’acquéreur.
Des modifications peuvent également être demandées par l’acquéreur, souvent appelées « travaux modificatifs acquéreur (TMA) ». Attention, ces TMA peuvent avoir pour conséquence de repousser le délai de livraison prévu au contrat (il s’agit généralement d’une cause légitime de retard).
Il faut formaliser tout refus par écrit. Sinon, il sera difficile de prouver que vous n’avez pas accepté la modification.
C. Le retard de livraison : causes légitimes et indemnisation
1) Sur le fond des causes légitimes de retard
Comme indiqué précédemment, dans une VEFA, la date de livraison indiquée dans le contrat est fréquemment dépassée. Les retards VEFA sont fréquents. En effet, de nombreux contrats permettent au promoteur de repousser la livraison sans pénalité, en invoquant des événements comme :
- des intempéries,
- des pénuries de matériaux,
- les grèves,
- les liquidations judiciaires d’entreprise,
- la découverte d’éléments de sous-sol pouvant nécessiter des travaux non prévus, etc.
Ces causes doivent toutefois être précises, vérifiables et extérieures au vendeur. Généralement, il appartient au maître d’œuvre de l’opération d’attester si tel ou tel événement a bien eu lieu.
Une clause trop large ou formulée de façon vague pourrait être qualifiée d’abusive. Par exemple, la mention générique d’un « retard du chantier » ne suffit pas à exonérer le promoteur sans justifications concrètes.
2) Sur la forme des causes légitimes de retard
Ces causes dites « légitimes » ne sont opposables à l’acquéreur que si elles répondent à un formalisme bien précis, généralement prévu au contrat.
Par exemple, si le constructeur évoque des intempéries pour expliquer un retard, il doit être en mesure d’en apporter la preuve, notamment par la production d’un relevé météorologique émanant de la station la plus proche du chantier. Sans ce justificatif, cette explication ne pourra pas être retenue, et le retard restera à la charge du promoteur, qui pourra être tenu d’indemniser l’acquéreur.
De même, en cas de difficultés liées à la nature du sol (instabilité, nécessité de fondations spéciales, etc.), la validité de cette cause de report dépendra de la transmission d’un document émanant du maître d’œuvre, confirmant les aléas rencontrés. En l’absence de cette pièce, le promoteur ne pourra pas invoquer cette circonstance pour échapper à sa responsabilité.
Il est par ailleurs courant que le contrat impose au promoteur d’informer l’acquéreur, dans un délai défini (souvent 15 jours), de la survenance d’un événement susceptible de retarder la livraison, et ce par lettre recommandée. Si cette formalité n’est pas respectée, même une cause légitime avérée pourrait être écartée.
En définitive, si vous subissez un retard de livraison et que le promoteur ne fournit aucun motif valable, ou ne respecte pas les conditions prévues par le contrat, vous êtes en droit de solliciter une indemnisation pour l’ensemble de la période de retard.
Dans ce contexte, il est vivement conseillé de relire attentivement l’acte authentique de vente afin de vérifier les clauses encadrant les retards autorisés, ainsi que les modalités de notification exigées.
3) Sur le montant du préjudice en cas de retard de livraison
Si aucune cause légitime n’est invoquée ou si le retard excède ce que la clause prévoit, l’acquéreur peut prétendre à une indemnisation. Pour cela, deux régimes coexistent :
a. Pénalités contractuelles :
Lorsque le contrat contient une clause de pénalités de retard, l’indemnisation est automatique dès que le dépassement est constaté. Ces pénalités peuvent être exprimées :
- soit sous la forme d’un montant forfaitaire par jour de retard (par exemple 15 à 50 €),
- soit sous la forme d’un pourcentage du prix global (souvent 1/3000e par jour en faisant référence aux dispositions concernant le CCMI).
b. Responsabilité civile contractuelle :
À défaut de clause précisant le montant des pénalités, il appartient à l’acquéreur de déterminer son préjudice comme :
- des frais de relogement,
- des loyers perdus,
- des intérêts intercalaires,
- des frais de garde-meuble,
- la perte d’un avantage fiscal type Pinel.
Il sera alors possible d’agir contre le promoteur sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
D. La livraison et les réserves
La livraison du logement donne lieu à la signature d’un procès-verbal entre le promoteur et l’acquéreur. Tous les défauts ou malfaçons visibles doivent y être notés sous forme de réserves.
L’acquéreur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception pour les signaler par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à l’article L 1642-1 du Code civil qui dispose que :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer »
III. Après la réception : garanties, recours et litiges en VEFA
A. La consignation du prix en cas de non-conformité en VEFA
En présence d’une non-conformité, il est possible de consigner 5% du prix de vente. Cette somme restera bloquée chez le notaire ou à la Caisse des dépôts jusqu’à ce que la non-conformité soit réparée par le promoteur.
Attention : en VEFA, cette possibilité n’est offerte qu’en présence d’une non-conformité, et non d’une simple réserve lors de la réception comme dans le cadre d’un CCMI. Les deux régimes juridiques sont différents sur ce point, et des confusions sont souvent opérées par les acquéreurs.
B. L’erreur de superficie en VEFA
L’un des litiges fréquents en VEFA tient à la disparité entre la surface annoncée et la surface livrée. Lorsqu’un acquéreur découvre après la livraison que son logement est plus petit que prévu, il peut agir en réduction du prix, mais sous conditions strictes.
L’erreur doit porter sur au moins 1/20e de la surface annoncée pour ouvrir droit à réparation. Autrement dit, une tolérance de 5 % est admise : en deçà, aucune action ne peut prospérer. Si cette limite est franchie, la réduction du prix est proportionnelle à la surface manquante.
Mais encore faut-il agir dans les temps. Le délai pour engager une telle action est d’un an à compter de la signature de l’acte de vente, ou de la remise des clés si elle intervient postérieurement.
Passé ce délai, l’action est irrecevable, même si l’erreur est manifeste.
Pour être recevable, la demande doit reposer sur une preuve technique : en pratique, il est indispensable de faire appel à un technicien (géomètre, expert) afin d’établir avec précision la surface réelle du bien. Ce rapport constitue le fondement de la réclamation.
Conseil pratique : dès la remise des clefs, il est impératif de vérifier les métrés réels du logement livré.
C. En présence de désordres, la mobilisation des garanties légales de construction
1. La garantie de parfait achèvement en VEFA
La garantie de parfait achèvement constitue la première ligne de protection pour l’acquéreur après la réception du logement. Prévue à l’article 1792-6 du Code civil, elle impose au constructeur de réparer tous les désordres signalés au cours de l’année qui suit la réception, qu’ils soient esthétiques, techniques, ou liés à une non-conformité aux plans ou à la notice descriptive.
Cette garantie s’applique automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de l’entrepreneur. Encore faut-il que l’acquéreur réagisse dans les délais et selon les formes prévues. Il est impératif de signaler les défauts par écrit, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant la nature des désordres, leur localisation et leur date d’apparition. Un simple mail ou échange oral ne suffit pas toujours à prouver que la demande a été valablement formulée.
En VEFA, la garantie de parfait achèvement est dirigée contre les entreprises ayant exécuté les travaux, et non contre le promoteur. En effet, dans le cadre d’une VEFA, le promoteur est qualifié de promoteur non réalisateur, ce qui exclut l’application de la garantie de parfait achèvement à son égard.
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l’acquéreur en VEFA peut et doit agir directement contre les entreprises ayant réalisé les travaux.
2. La garantie biennale
La garantie biennale, prévue à l’article 1792-3 du Code civil, couvre pendant deux ans les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, c’est-à-dire ceux qui peuvent être enlevés ou remplacés sans détériorer le gros œuvre. Cela inclut par exemple : les volets roulants, les VMC, les hottes aspirantes, les ascenseurs, etc.
Cette garantie vise les dysfonctionnements de ces équipements, même mineurs. Il n’est pas nécessaire de prouver une faute de conception ou d’installation : le simple défaut de fonctionnement suffit à engager la responsabilité du constructeur. Là encore, la démarche repose sur un signalement écrit, de préférence daté et documenté, pour éviter toute contestation.
En cas de silence du promoteur ou d’absence de réparation, l’acquéreur peut engager une procédure judiciaire, fondée sur cette garantie, pour obtenir le remplacement ou la remise en état des équipements défectueux.
3. La garantie décennale
La garantie décennale, prévue à l’article 1792 du Code civil, protège l’acquéreur pendant dix ans à compter de la réception contre les désordres de nature à :
- compromettre la solidité de l’ouvrage (fissures, affaissement de plancher, problèmes de fondations),
- ou rendre l’ouvrage impropre à sa destination (infiltrations, défaut d’isolation, étanchéité défaillante).
Sont concernés par exemple : les fissures importantes dans les murs ou les planchers, les affaissements de terrain ou de dalles, les défauts structurels liés à une mauvaise étanchéité, une isolation défectueuse, ou encore des infiltrations.
À noter : les malfaçons purement esthétiques ou les défauts mineurs, sans impact sur la solidité ou l’usage du bien, n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale.
La garantie s’applique aux ouvrages principaux (fondations, murs, toiture…), mais également aux éléments d’équipement indissociables, c’est-à-dire ceux qui font corps avec le bâtiment et dont le retrait ou le remplacement endommagerait l’ouvrage (par exemple : réseaux encastrés, planchers chauffants, etc.).
Tout désordre survenant dans ce périmètre, même s’il ne se manifeste que plusieurs années après la réception, engage de plein droit la responsabilité des constructeurs intervenus à l’acte de construire (architectes, entreprises…).
En cas de sinistre de nature décennale, l’assurance dommages-ouvrage peut être mobilisée pour accélérer l’indemnisation.
4. L’assurance dommages-ouvrage en VEFA
En VEFA, l’assurance dommages-ouvrage (DO) est obligatoire. Elle doit être souscrite par le promoteur au profit de l’acquéreur. Son rôle est simple : indemniser rapidement les réparations relevant de la garantie décennale, sans nécessité de prouver la responsabilité du constructeur.
Elle couvre, à l’issue de la première année après la réception, tous les désordres de nature décennale, affectant la solidité ou l’habitabilité du logement (infiltrations, fissures, affaissements…).
L’assurance DO permet de :
- obtenir une indemnisation rapide,
- faire réparer sans attendre l’issue d’une procédure,
- éviter de financer soi-même les travaux, même en cas de litige entre constructeurs.
Avant de signer l’acte de vente, l’acquéreur doit vérifier que l’attestation d’assurance DO est bien annexée au contrat. En cas d’absence, vous ne pourrez plus bénéficier de cette voie rapide d’indemnisation. Si l’assureur DO refuse de prendre en charge les désordres, vous pouvez contester sa décision devant le juge.
Le cabinet MARTIN PEYRONNET, avocat en droit immobilier et droit de la construction à Bordeaux, se tient à votre disposition pour vous assister dans tous vos litiges immobiliers, à Bordeaux comme dans toute la France.
Dernière mise à jour le 9 août 2025 par Martin Peyronnet