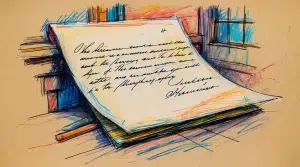Le recouvrement de sa créance est souvent menacé par l’insolvabilité de son débiteur. Afin de prévenir une telle difficulté, la mise en œuvre d’une saisie conservatoire est conseillée et souvent utiliser en droit immobilier notamment.
Une saisie conservatoire est une procédure permettant à un créancier de bloquer provisoirement les biens d’un débiteur afin de garantir le paiement de sa future créance. Cette procédure vise à garantir que les biens du débiteur seront disponibles pour le recouvrement de la créance.
I. Les biens pouvant faire l’objet d’une saisie conservatoire
Selon l’article L.521-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur.
Il existe plusieurs types de saisies conservatoires : la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels, la saisie conservatoire des créances (saisies de sommes d’argent sur le compte bancaire), la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières et la saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort.
Cependant, certains biens demeurent insaisissables car ils sont nécessaires à la vie courante et au travail du débiteur ainsi que de sa famille.
II. Les conditions d’application de la saisie conservatoire
Selon l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la créance doit paraître fondée en son principe et justifiée de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
A. Une créance fondée en son principe
La créance ne doit pas forcément être certaine, liquide et exigible. En effet, une créance vraisemblable en apparence peut suffire, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être nécessairement chiffrée.
B. Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
S’agissant de la deuxième condition relative aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il est nécessaire d’apporter des éléments justificatifs objectifs.
La jurisprudence rappelle le principe constant selon lequel l’importance du montant de la créance à recouvrer, peut à elle seule, constituer une circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement au sens de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CA Paris, 9 septembre 2021).
En outre, les circonstances menaçant le recouvrement de la créance auront principalement trait à la solvabilité du débiteur, que celle-ci soit insuffisante pour assurer le règlement de la créance, qu’elle soit incertaine, fortement douteuse ou que son insolvabilité soit imminente (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 mai 1979, n° 78-11.782).
Ne sont pas caractérisées des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance : lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier important (Cour d’Appel de Colmar, 10 janvier 2010, n° 09/04929). Il en va de même lorsque le débiteur possède des revenus et avoirs lui conférant une aisance financière certaine (Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 7 juin 2012, n° 11-16.106).
III. Le risque d’une saisie conservatoire abusive
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Toutefois, l’exécution de ces mesures ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La jurisprudence considère que le droit d’user des mesures conservatoires et des voies de recours offertes par la loi ne saurait dégénérer en abus qu’en présence de la mauvaise foi ou de la faute du créancier (Deuxième chambre civile de la Cour de cassation,17 octobre 2013, n°12-25.147).
Attention, selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation n°74-13.921, en date du 20 janvier 1976, « la faute imputable au créancier peut résulter d’une simple imprudence fautive ou erreur grossière, ou plus radicalement d’une véritable intention de nuire ».
Il conviendra de veiller à ce qu’aucune faute ne soit commise pas les créanciers dans la mise en œuvre de la saisie conservatoire. Cela permettra d’éviter que la saisie soit qualifiée d’abusive ainsi que toute demande de dommages et intérêt par les débiteurs.
La mise en œuvre d’une mesure de saisie conservatoire implique également le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité de la mesure. La disproportion consiste dans l’utilisation d’une mesure inutile ou excessive pour obtenir le règlement d’une créance. Il appartiendra aux commissaires de justice de vérifier si la consistance des biens qu’ils saisissent est suffisante pour assurer le paiement total ou partiel de la créance.
IV. La mise en œuvre de la procédure
Afin de mettre en œuvre une saisie conservatoire, une autorisation préalable du juge est nécessaire. Toutefois, il est fait exception à cette règle si le créancier dispose d’un titre exécutoire.
A. Le tribunal compétent
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des mesures conservatoires et des contestations relatives à leur mise en œuvre selon l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. Il s’agira plus précisément du juge du lieu où demeure le débiteur, selon l’article R.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
B. Les formes de la demande
La demande devra être formée par requête, laquelle n’interrompt pas la prescription. Si le juge rejette la demande, le créancier peut interjeter appel dans un délai de 15 jours.
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
V. Les contestations du débiteur
Le débiteur peut contester la saisie conservatoire s’il estime qu’elle n’est pas justifiée, et ce même lorsqu’une autorisation préalable du juge n’est pas requise selon l’article L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il pourra également demander la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il incombera alors au créancier de prouver que les conditions requises pour la saisie conservatoire sont réunies (Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 6 octobre 2005, n° 04-12.063).
VI. L’exécution de la mesure conservatoire
La mesure exécutoire devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. A défaut, l’ordonnance sera frappée de caducité.
VII. La conversion de la saisie conservatoire en saisie définitive
Une hypothèque judiciaire conservatoire n’a pas vocation à perdurer. En effet, elle vient provisoirement paralyser les biens du débiteur. En conséquence, le créancier devra effectuer les formalités nécessaires afin d’obtenir un titre exécutoire, dans un délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire.
VIII. La saisie conservatoire et la procédure d’injonction de payer
La procédure de saisie conservatoire et la procédure d’injonction de payer peuvent se cumuler. La saisie conservatoire peut intervenir avant même le début de la procédure d’injonction de payer ou bien à la suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Une telle combinaison permet souvent de mettre davantage de pression sur le débiteur tout en sécurisant l’exécution.
Conclusion
En conclusion, la mise en œuvre d’une saisie conservatoire est opportune et conseillée en ce qu’elle permet aux créanciers de se prémunir des risques dans le recouvrement de leur créance. Elle permettra de transformer la saisie conservatoire en saisie définitive, mettre la pression sur les débiteurs, et éviter d’éventuels concours avec d’autres créanciers, notamment dans le cadre de ruptures de marchés ou de diagnostics erronés.
Le cabinet Martin PEYRONNET, avocat en droit immobilier à Bordeaux, se tient à votre disposition pour vous assister dans tous les problèmes que vous pourriez rencontrer en matière de recouvrement de créances.
Dernière mise à jour le 6 août 2025 par Martin Peyronnet